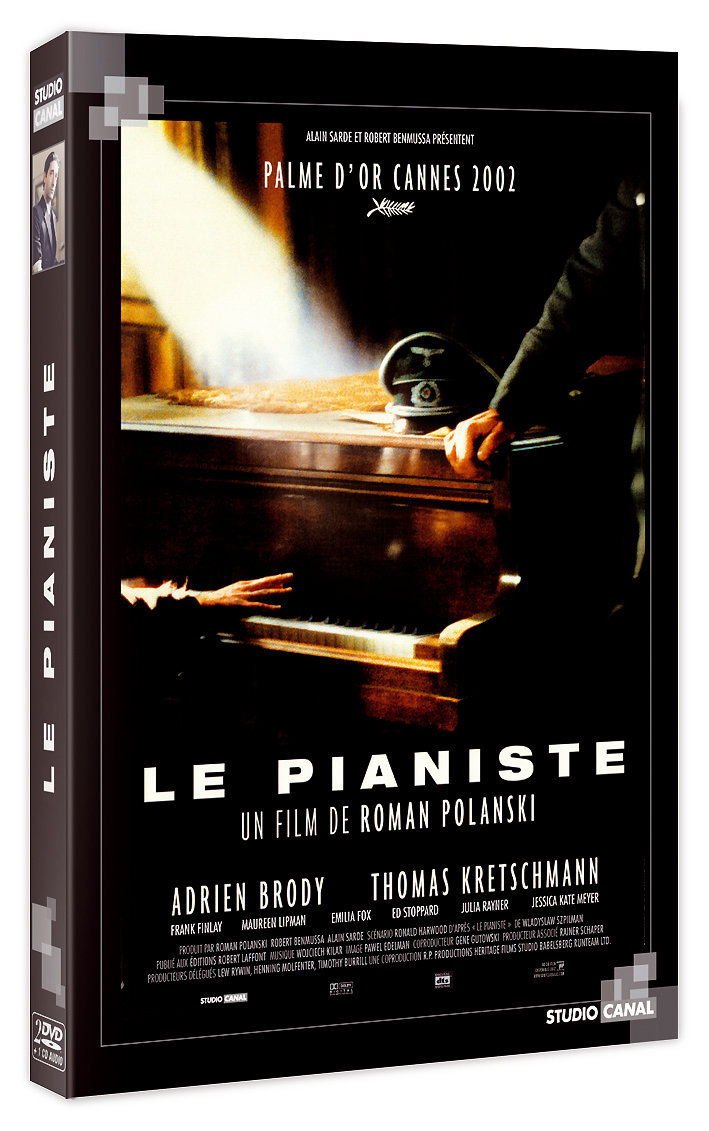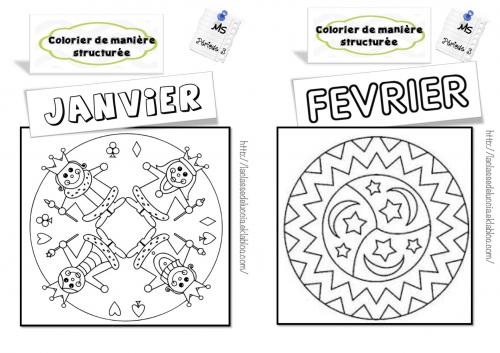Un regard-caméra. Voilà comment se conclut finalement la huitième et dernière saison de Dexter. Le procédé, censé bousculer le spectateur et briser le quatrième mur de la vraisemblance, n’a pourtant pas vraiment fait trembler ceux de nos salons ; il faut dire que plusieurs récits contemporains centrés sur des psychopathes ont déjà précisément choisi de refermer leur histoire ainsi – on peut, récemment, penser à l’adaptation cinématographique d’American Psycho ou à la belle conclusion de Damages.
Où, cependant, ces deux exemples convoquaient le regard-caméra pour insister sur l’impénétrabilité de leur personnage, sur la folie transpirant le long de chaque pores de leur peau, sur l’impossibilité de s’extraire de l’aliénation, bref, sur l’impasse totale, Dexter, ici, s’en sert à d’autres escients. Celui, en fait, de reconnaître qu’il était légitime d’attendre que Dexter soit jugé par la société, que ses meurtres soient découverts par cette dernière… mais que, cette société, elle ne sera pas diégètique ; que, si le regard-caméra a attendu 96 épisodes pour jaillir enfin, c’est parce qu’il est là pour nous révéler que ce jugement tant attendu, il nous incombe à nous, spectateurs. « Jugez-moi, maintenant »… Dexter, sur sa vieille chaise en bois comme sur une chaise électrique, attend notre sentence. Il aurait pu mourir dans la tempête, mais il ne l’a pas fait. Il aurait pu vivre avec Hannah, mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il s’est extrait, dans un monde ni vraiment fictionnel ni vraiment réel, dans cet espace reliant le spectateur à la série1 ; ici, il va rester, dans cette petite chambre boisée où nous pourrons prendre une décision, l’un après l’autre.
Ainsi, vous le comprenez, cette critique ne sera pas une critique : ce sera une exécution. Parce qu’après huit saisons de bon et de moins bon, il est venu le temps pour Dexter de passer sur notre table. On l’y a bien scotché, on lui a prélevé un échantillon de sang et on a déjà commencé à lui faire défiler quelques photos de ses méfaits – et finalement, la série n’a pas l’air de protester. Elle semble plutôt hausser les épaules. Donc c’est parti – nous voici en train de nous pencher pour la dernière fois sur Dexter. Et on va y aller au marteau. Objectivement, mais au marteau.
Commençons d’abord par l’immense problème qui ronge Dexter depuis la saison 5 et que sur lequel nous revenions déjà ici2 : l’incapacité totale de la série à s’opposer à son personnage, à s’élever au dessus de lui pour le placer au centre d’un véritable conflit philosophique. Cet infâme écueil arrivait à son apogée dans la saison 7 où tout, absolument tout, dans le récit, était redirigé, remodifié, transformé pour convenir à Dexter (ses victimes étaient plus que jamais d’horribles néo-nazis, le tueur de sa mère n’avait absolument aucun regret, le fils d’une de ses anciennes victimes était bien plus heureux maintenant que son père était mort, etc…). Contre-sens total puisque la série n’avait jamais été aussi bonne que lorsqu’une voix forte s’opposait à celle de Dexter, désireuse de le bousculer, de le dégager, même, de sa petite série qu’il semblait trop facilement contrôler. C’est précisément pour cela que la quatrième saison fût une si grande réussite ; avec l’introduction d’Arthur Mitchell – le Trinity Killer – le récit s’élargissait comme jamais, nous plongeant dans le quotidien d’une autre forme de noirceur sans que Dexter n’en sache rien ou que son insupportable voix over nous vienne dire quoi en penser. En nous permettant de prendre de l’avance sur Dexter, en nous laissant, en certaines occasions, passer de l’autre côté du rideau, un grand tableau alors pouvait s’étendre…
Toute proportion gardée, il faut donc reconnaître à la série, qui se tient silencieuse sur notre table, que l’apparition de Evelyn Vogel fût judicieuse. Nous propulsant à la fois vers l’origine du problème, chose essentielle pour la fin d’un récit, le personnage incarné par Charlotte Rampling interpelle de par sa qualité de relais spectatoriel tout à fait honnête. Honnête parce que, enfin, quelqu’un vient poser les questions qui fâchent – « qu’est-ce qu’un monstre ? », « l’amour de Dextra pour Debra est-il valable, passé outre les petites sornettes des voix over ? », etc… Honnête, aussi, de par sa folie, de par son désir d’embrasser Dexter dans sa notion de tueur – car, ici, la série révèle au grand jour ses propres tourments, sa volonté obsessive de toujours défendre son personnage principal, d’en faire presque un héros, un vigilante noble, un Batman… Vogel, ici, pose donc un corps sur le spectateur naturel d’une série bel et bien malade – et tout de suite, le récit gagne en questionnement. Tout de suite, on s’élève au-dessus des mensonges de Dexter pour emprunter un courant émotionnel plus véritable – celui sur la dualité, sur les aspérités du monstre. Incontestablement, l’ensemble s’en trouve amélioré, de Quinn, dans sa volonté de s’attacher à Debra, à Harrison, et sa passion maladive pour les glaces…
Premier verdict, donc : les quatre premiers épisodes de la saison, conclus par le plongeon suicidaire de Debra entraînant Dexter avec elle, sont, sans être exceptionnels, d’une qualité inespérée compte-tenu des dernières saisons. Mieux, la série parvient alors même à viser deux fois dans le mille : d’abord dans le season premiere, quand Debra affirme à Dexter être en enfer et le mériter, lorsque lui est en revanche nulle part, simplement perdu3… ici, la série admet brillamment sa difficulté à affronter la réalité de son récit, sa tendance désespérante à errer, voire stagner, dans un entre-deux, trop effrayée par sa véritable noirceur, par, oui, le grand funeste et les flammes de l’enfer… qui, de manière ultime, surgiront lors du dernier épisode. L’autre moment bien aiguisé, il survient quand Debra découvre que son père s’est suicidé à cause de son fils adoptif, à travers une phrase, toute simple : « No one deserves to be in pieces… in bags ». Là encore une voix forte s’élève – une voix de l’évidence, de la naïveté, presque, qui, pourtant, fait vaciller les choses. Il est alors clair que c’est exactement ce dont a besoin la série – de notions évidentes et surélevées.
Puis, avec le cinquième épisode, vient le second arc de la saison. Et, inexplicablement, la série commence à faire marche arrière comme si elle avait été reconduite pour deux saisons supplémentaires. Dexter, tranquillement, est redirigé vers le confort, vers l’absence de contestation – constat d’autant plus douloureux que cette frilosité habituelle entraîne pour la première fois Debra avec elle, qui, en quelques minutes, tombe dans les bras de Dexter après avoir tenté de l’assassiner – avant quelques épisodes plus tard, d’aller même jusqu’à héberger Hannah, comme si les quinze derniers épisodes n’avaient pas réellement existé. Lentement mais sûrement, on s’éloigne du sujet, de ses pulsions propres, du sang qui coule de la blessure introductrice et dont il faut absolument suivre l’écoulement.
Pire, les ridicules voix over de la saison 7 « Oh, Hannah, je ne pense qu’à toi », « Oh Hannah, comme je donnerais pour tout pour redevenir insensible » signent leur grand retour, collant de la poésie de pacotille sur des images qui n’expriment rien – en somme, quelque chose d’à peu près aussi insensé qu’une œuvre médiocre nous chantant « oh, quelle œuvre magnifique que je traverse… ». Quant aux rares bonnes idées, elles sont malheureusement pour la plupart gâchées. Prenons deux exemples : d’abord, le personnage de Cassie, la voisine, qui cherche à percer le « mystère Dexter » et qui trouve du charme à l’étrange. Incontestablement, il y a là un bon protagoniste tant elle représente parfaitement le spectateur type de Dexter : à savoir une femme, qui aime à s’imaginer comme la rédemptrice d’un homme sombre – qui reste persuadée qu’il y a quelque chose à sauver même chez le pire des hommes, qui, face au vide absolu, à l’absence totale de définition, de sujet ou de sens, ne bronche, finalement, jamais – qui, inlassablement, allume sa télé. Comme nous. Ce personnage, oh, qu’il fût infiniment plus osé et profond que ce soit Dexter lui-même qui la tue…
Autre idée mal exploitée, celle de l’apprenti, dotée évidemment d’un certain potentiel compte tenu de l’importance de l’héritage à l’aube de toute fin. Problème : si son sort, en tant que tel, assez brutal, n’est pas dénué de sens, son introduction est trop bâclée. Il eut fallu qu’il apparaisse plus tôt dans l’histoire, pas forcément dans sa rencontre avec Dexter mais dans son existence propre : qu’on le voit évoluer, hésiter, basculer… cela fût autrement plus intéressant que de le voir surgir d’une intrigue secondaire, avec collé sur lui, de la même façon, « personnage secondaire ». En somme, ce deuxième tiers nous refroidit, nous ramène à cette fâcheuse réalité qu’est devenue celle de Dexter ; les épisodes 5 à 8, sont oui, d’un niveau devenu habituel – médiocres. Et en passant les photos de ces derniers devant le corps ligoté de la série, force est de constater que l’on devient franchement pessimiste quant à son avenir. Mais, en cet instant, il nous vient, oh, grande surprise, de la compassion – il nous vient l’envie de revenir un peu sur ses géniteurs. Sur les raisons du mal – sur, en somme, ses scénaristes. Parce que, en fait, en France comme ailleurs, personne n’évoque vraiment ce qu’est devenue la salle des scénaristes de Dexter avec le temps. Mais, oui, nous y songeons alors, nous compatissons : les parents de Dexter, ah, ce sont des hyènes.
Il suffit de voir l’épisode 5, de voir cette redirection désastreuse du récit, pour le comprendre, qu’il y a quelque chose de pourri dans cette salle là. Une patte, très visible, qui ne cesse de se fourvoyer, qui part toujours à contre-sens. Il est donc essentiel, avant de réserver tout jugement, de revenir brièvement sur l’histoire créative de Dexter.
Au commencement, il y avait deux hommes : Jeff Lindsay, l’auteur, bien sûr, du livre Darkly Dreaming Dexter, et James Manos Jr., le scénariste qui l’adapta pour la télévision. Or, après l’écriture de l’épisode pilote, Manos Jr. fût rapidement débarqué par Showtime et remplacé par Clyde Phillips. On comprend donc tout de suite que le poste de numéro 1, dans l’entreprise Dexter, n’est pas acquis – il n’y a pas d’auteur proprement dit ; il y a surtout un poste, qu’il faut s’efforcer de garder. Et ce poste, Phillips, à la fin de la saison 4, décida de le quitter, épuisé par quatre longues années d’écriture sombre et violente. Mais, alors que Showtime aurait pu logiquement privilégier une solution interne et promouvoir le numéro 2 de Phillips, Scott Buck, la chaîne préféra une solution externe, soit celle de Chip Johannessen, libre depuis la fin de 24. Étrangement, alors qu’avec Johannessen la série signe ses plus belles audiences, le scénariste se retrouve lui aussi vite débarqué… pour, finalement, laisser le pouvoir à Scott Buck, resté patiemment numéro 2. Buck, pendant les trois ans de son règne, soit les trois dernières saisons de Dexter, va opérer une politique on ne peut plus douteuse : en effet, malgré l’épuisement créatif évident de la salle des scénaristes, Buck ne va jamais recruter quiconque (ou, en tout cas, aucun nom confirmé), préférant au contraire promouvoir, les uns après les autres, les scénaristes déjà présents. L’histoire, en fait, est banale, on l’a vue ou vécue dans des tas d’entreprises : Buck, face à un poste qu’il sait instable, a compris que pour accéder au pouvoir et, surtout, être capable d’y rester, il fallait obtenir le soutien de ses collègues ; il leur a donc, selon toute évidence, promis un poste jusqu’à la fin, et, surtout, aucune concurrence extérieure. Que les promotions qu’il a attribuées n’étaient absolument pas méritées compte tenu de la qualité des saisons 6 et 7, ou que la série elle-même avait clairement désespérément besoin de sang frais ne l’a visiblement jamais gêné : le monsieur a tout fait pour garder son poste. Voilà le genre de choses internes et non-dites qui, comme par miracle, explique bien des choses.
C’est d’ailleurs sans surprise que, parmi tous les Executive Producer du programme (parmi lesquels on retrouve cinq scénaristes4), aucun d’entre-eux n’est réalisateur. En effet, après le départ de Michael Cuesta, réalisateur en chef de la première saison et Co-Executive Producer (depuis passé par Homeland), Buck, et même Phillips avant lui, n’ont jamais cru bon de recruter un réalisateur attitré, se tournant plutôt vers des « agents libres », des baroudeurs allant de série en série5. Ainsi, l’équipe créative « sauvait » un poste de producteur exécutif pour eux, scénaristes, au détriment du besoin, là encore évident, d’un réalisateur en chef. Sur les trois dernières saisons, ce manque est flagrant tant, lorsqu’on regarde Dexter, on a la sensation de rester enfermé dans les mêmes murs, en permanence – et pas des beaux murs sombres ruisselant la claustrophobie et dont on aurait l’impression qu’ils se rapprochent de nous, non ; des murs grisâtres, dont on ne perçoit même plus la matière tellement on les a vus et dont seul le fait qu’ils obstruent l’horizon leur octroie une existence, un rôle. Pour une série de seulement douze épisodes par an et avec de telles audiences – et donc un tel budget –, c’est purement et simplement anormal. Mais, clairement, l’épanouissement créatif du programme n’était pas dans l’intérêt de tous… Ainsi, oui, la compassion, est là. « Pauvre, Dexter… », pensons-nous face à la série sur notre table. « On t’a laissé mourir… ».
Puis, nous nous ressaisissons. Les épisodes 9 et 10, vraiment, non, non, non… ils sont impardonnables. Quand même, il faut le voir, Dexter, tueur en série méticuleux, s’en aller sur son ordinateur – plusieurs jours après avoir décidé avec l’amour de sa vie qu’ils partaient en Argentine – pour taper, sur google… « Argentine » ; il faut le voir, ce brave Harrison, se cognant sur le tapis de course trente secondes après qu’il ait été établi que Hannah ne peut en aucun cas sortir en public ; il faut le voir, ce magnifique logiciel de vieillissement, nous donnant un visage informe ressemblant moins à Sexton (dont, comme par miracle, Dexter murmure le nom…) qu’à… Dexter lui-même. Et, oh, il faut l’entendre, aussi, cette utilisation abominable de Make Your Own Kind of Music ; abominable d’abord parce que, si l’on avait pas déjà établi que les scénaristes de Dexter sont des hyènes, on pourrait croire que ce sont des chimpanzés, tellement il est absurde que Vogel reconnaisse la musique uniquement parce qu’elle l’a entendue lors de l’effraction – alors que, quelques minutes plus tard, elle explique à Dexter que ses meilleurs moments passés avec son fils l’ont été avec, pour bande-son… Make Your Own Kind of Music ; abominable, aussi, parce que le thème même de la chanson est celui de l’originalité et de la liberté, de la jouissance d’être pionner – contre-sens total ici, puisque, pour tout sériphile averti, cette musique là, c’est Lost, sa trappe et des souvenirs d’une beauté qui non seulement ridiculisent la médiocrité de Dexter mais soulignent son manque flagrant de personnalité, et le fait, donc, qu’elle n’a aucune musique intérieure propre. Là, vraiment, on se sent défaillir.
Se présente alors l’avant-dernier épisode. Au début, on a un peu du mal à y croire. La dernière intrigue de Dexter, c’est donc ça ; c’est donc « Dexter va-t-il réussir à rejoindre l’Argentine avec la femme qu’il aime ? ». La saison 7 avait beau être ratée, son conflit final nous propulsait vers le courant véritable : « Dexter mérite-il d’être puni ? » (la réponse, elle, laissait à désirer…). Ici, on en vient à se dire qu’on pourrait remplacer Dexter par un personnage lambda. « Richard va-t-il réussir à rejoindre l’Argentine avec la femme qu’il aime ? ». « Carlos va-t-il réussir à rejoindre l’Argentine avec la femme qu’il aime ? ». « Abdel-Kader va-t-il réussir à rejoindre l’Argentine avec la femme qu’il aime ? ». Dans tous les cas, ça sonne mal. A vrai dire, cette série de l’anti-escalade, lorsqu’un Breaking Bad, traité sériel de l’escalade, se conclut presque en même temps, commence même à nous faire pitié. On réalise, avec dégoût, que Michael C. Hall n’a pas évoqué en nous de l’effroi depuis des années ; qu’il n’y a chez lui plus jamais aucun éclair de vérité, de fièvre. Où sont les pures ténèbres, bon sang ? C’est même à en exploser de rire… surtout lorsque Sexton et Dexter s’opposent dans l’appartement de ce dernier, à travers une séquence qui pourrait être parodique tant aucun des deux acteurs n’ont quoi que ce soit de meurtrier. On comprend le truc, on comprend que Sexton est censé être comme Dexter, avoir un physique banal et refléter le fils qui n’a pas eu de code – mais cela, on l’a déjà vu huit saisons plus tôt, et cette relecture, avec ces deux acteurs vraiment tout tout mous, nous laisse plutôt l’impression de regarder Philippe Harel et José Garcia – deux petits employés de bureau Houellebecquien jouant aux tueurs ; qui en parlent, mais qui le savent très bien, qu’ils ne dépasseront pas la théorie. Des types banals, quoi. Ah, clairement, plus que jamais, ça nous donne envie de rentrer dans le lard, de bien la faire saigner sur la table, cette série.
Dans ce pénultième épisode, un instant scintille, cependant. Le « Vous me manquerez aussi » de Dexter, lors de son pot de départ. Pourquoi ? Parce que c’est le seul moment de vérité – le seul moment où le courant émotionnel est touché, où nous y sommes synchronisés. Parce que, comme Dexter, nous avons quand même un petit pincement au cœur de quitter la série ; et, comme Dexter, nous en sommes un peu étonnés… Mais, néanmoins, il va de soi que cette surprise à ressentir de l’émotion vient de deux trajectoires bien, bien opposées… En effet, Dexter est surpris, car de la froideur, il est devenu plus humain ; nous, en revanche, le sommes car, au contraire, de l’émotion ressenti initialement, nous avons fini par nous en foutre. Destin opposé, donc, pour une série à la ramasse ! Il est là, oui, le cœur du problème – dans cette question toute simple : comment traiter de l’éveil émotionnel d’un personnage quand, au contraire, la série se ferme, s’éteint et, oui, fait semblant ; car Dexter a beau tomber le masque, « s’abandonner à quelqu’un », le fait est que la série, elle, nous regarde comme Dexter le faisait au premier jour : c’est un gros mensonge, oh oui, que cette œuvre filmique se refermant devant nos yeux. La voilà, en train de prétendre qu’elle est quand elle n’est pas ! Là est le véritable monstre ! Celui qui n’est que néant. Ah, il nous a fallu plusieurs années pour le débusquer… Mais désormais, il est là, sur notre table ! Nu sur la scène – là où il n’est rien. C’est la série même ! Retenons cependant encore un peu notre lame…
« It’s hard to find mountains in Florida », nous dit Debra dans le series finale. Bel aveu, pour une série de l’anti-escalade. Mais pas une excuse suffisante : les montagnes, ça se construit avant de se gravir. Et là, vraiment, on est à bout, même un peu cynique, parce que, qu’est-ce que c’est gros, comme allégorie de la fin, que cette tempête ! On en devient méprisant, aussi : on crache sur cette série à la lame si peu aiguisée que, jamais, on ne croit à la mort de Debra – et, après huit saisons sur un tueur en série, c’est un problème. On balaye de la main des phrases comme « It’s just an absence of light, Deb », incorporées pour défendre Dexter, pour, encore une fois, ne pas traiter les ténèbres – puisque, bah non mon bon ami, si c’est juste une question d’absence de lumière, alors y a pas d’ténèbres. Est-ce que vous rigolez ? Est-ce que vous rigolez ?, demande-t-on, en serrant la mâchoire. Et quand, pour une fois, l’absence de lumière, puisqu’on va l’appeler comme ça, est capturée ; quand, pour une fois, Dexter est filmé dans un meurtre ; quand la sûreté de son geste, la maîtrise, la froideur et l’aspect clinique se pose, là, clairement et avec une certaine beauté, il faut le dire… personne ne réagit. Pas même Batista, qui se doit alors de comprendre que Laguerta avait raison depuis le début… Ah, et qu’on ne vienne pas m’objecter qu’il comprend, mais qu’il laisse passer… il s’écrase, comme tous les autres. Oh Dieu Absence de Lumière ! Comme tu es intouchable !
Et puis vient la mort, la vraie, enfin. D’abord lorsque Absence de Lumière débranche sa sœur. Évidemment, ça ne pèse pas trop sur le cœur ; il aurait fallu que ce soit un minimum étirer sur le temps ; mais on est au bord du gouffre, presque tombé dans l’obscurité de la fin, alors l’action est là, elle doit être là, et on pardonne – mais forcément, on continue de ne pas y croire. On continue de penser à ce « miracle », évoqué précédemment… ce miracle qui, à nos yeux, ne devrait pas être celui de la vie qui jaillit, et qu’on devine trop, mais celui de la mort, enfin ! Là serait le vrai miracle de cette série – que la lame tranche, enfin, quelque part. Et alors elle tranche. Et alors, oui, le miracle survient. Et voir Dexter, sous les torrents de pluie, sortir avec le corps de sa sœur enveloppé, sans que personne ne s’en rende compte, dans un élan non pas irréaliste mais poétique et qui touche enfin au sublime, à la surélévation, au rapport direct avec les forces de la nature, avec la mort qu’on ne peut plus éviter du regard – et bien, ce passage est beau. On peut voir, enfin, quelque chose dans le corps de Michael C. Hall : on peut enfin voir le personnage reprendre vie, le cœur de l’enfant battre, le cœur du frère battre, celui sur lequel est tombé le drame, celui qui lutte, celui qui essaye de faire du mieux qu’il peut. Et le visage de Deb qui sombre, qui coule, qui ne ressortira pas, là-encore contre toute attente, alors que le « miracle » – en fait le drame – semble tout prêt de se réaliser, et bien c’est quelque chose. Ce visage qui coule dans le noir et qui y restera, là, enfin, enfin, on y est. Enfin les grandes entrailles du mal ! Enfin la tempête ! Ouf. On respire.
Tout le reste est secondaire, même le regard-caméra, même le jugement qui nous incombe. La lame a fini par faire mouche. Le regret est qu’elle aurait dû y parvenir dès la cinquième saison, dans la continuité même du tueur de la trinité. Mais quelques hyènes sont passées par là. Les circonstances. Les egos. Bon… il faut croire que cette pauvre série en a eu assez pour aujourd’hui. Il faut croire qu’on peut la laisser s’en aller, saine et sauve, finalement… qu’est-ce que le couteau pourrait encore en tirer, de toute façon ?
NOTES
1Cela rappelle d’ailleurs sensiblement la Red Room de Twin Peaks dans laquelle – spoiler alert – l’agent spécial Dale Cooper est condamné à rester coincé…
3I am in some shitty fucking hell, which is exactly what I deserve. But you…you are lost.
4Scott Buck, Manny Coto, Wendy West, Tim Schlattmann et Jace Richdale.
5Parmi les plus fréquents, John Dahl, Steve Shill, Marcos Seiga, Ernest R. Dickerson ou Keith Gordon… que des « baroudeurs » n’ayant jamais obtenu de poste fixe sur une série et qui peuvent aller jusqu’à travailler sur cinq différents programmes dans l’année (bien que Marcos Seiga, après son passage sur Dexter, s’est lui finalement imposé comme l’un des hommes importants de Kevin Williamson, obtenant un poste de Co-Executive Producer sur The Vampire Diaries et d’Executive Producer sur The Following).
The post Dexter, saison 8 – la Mort, enfin appeared first on yes future.